
Après trois semaines à traîner un rhume qui dégénère, Jordan Bélanger finit par pousser la porte de la clinique Infirmia, à Québec. Il en ressort une heure plus tard, ordonnance en main et délesté de 80 $ (50 €). Un montant qui vaut largement le coup, selon lui.
« À l’hôpital, j’aurais attendu des heures avant de voir un médecin. Même chose pour mon médecin de famille, en cabinet et sans rendez-vous. Et pour un rendez-vous, c’est minimum un mois ». En effet, la province connaît une pénurie de médecins de famille : en 2015, 420 000 Québécois en étaient dépourvus.
Pour Jordan, la logique est simple : le temps, c’est de l’argent. Mais c’est aussi la qualité du service qui a poussé Jordan à confier sa santé à des infirmières. Il compte parmi les quelque 3 000 patients d’Infirmia.
[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]“ Aux urgences, les aberrations devenaient frustrantes. Je n’étais pas habilitée à donner des analgésiques de base sans l’approbation du médecin. C’est d’autant plus absurde que les patients n’avaient qu’à traverser la rue pour en trouver en vente libre à la pharmacie d’en face.”[/dropshadowbox]
David Tremblay-Deschênes, infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne (IPS-PL) et co-fondateur d’Infirmia, estime que c’est « l’expérience santé qui fait que les gens s’attachent et reviennent ».

Un ton qui emprunte au monde des affaires ? Et pour cause. Privées, ces cliniques sont de véritables entreprises. Ce qui n’empêche en rien, selon David, de placer le soin et l’humain au coeur de son travail. Au contraire : ce sont justement des années de pratique au sein du réseau de santé public qui l’ont poussé, avec sa collègue Isabelle Lechasseur, à se lancer dans l’aventure. « Je ne me contente pas de remettre une ordonnance, souligne cette dernière. J’explique au patient ce que je lui prescris et pourquoi. Le Québec fait face à des enjeux d’accessibilité [aux soins de première ligne] et notre modèle reste trop médico-centré. Soit on a un médecin de famille, soit on va aux urgences. Pourtant, comme infirmières, nous pouvons dispenser de nombreux soins. En prenant le temps de poser des questions pour comprendre nos patients, dépister les risques, conseiller pour améliorer ce qui peut l’être. On fait dans le préventif plutôt que dans le curatif. »
Plus d’autonomie

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) prône davantage d’autonomie pour ses membres. « L’OIIQ souhaite que les infirmières puissent exercer à la hauteur de leurs compétences », assure Suzanne Durand, directrice du service de soutien et de développement professionnel de l’Ordre. Aux États-Unis et dans les autres états canadiens, ce cap est passé depuis longtemps.
Au Québec, elles disposent aussi d’un large éventail de compétences, mais souvent peu mises à profit. Si les mentalités tendent à changer, le médecin fait encore autorité. Pourtant, les actes qu’elles sont habilitées à assumer permettent sans équivoque une pratique autonome en clinique. Suzanne Durand tient néanmoins à préciser « que l’expression d’usage « clinique sans médecin » est erronée. Le règlement qui encadre la pratique infirmière autonome en clinique privée prévoit que celles-ci soient rattachées à au moins un médecin partenaire. Il doit être géographiquement accessible et disponible pour les patients, au besoin. Et les infirmières doivent pouvoir s’y référer si nécessaire. »
Un engagement bénévole de la part de médecins qui y voient un outil pour concentrer leur propre pratique sur des problématiques plus complexes. Mais les cliniques ont rarement besoin de ce filet de sécurité. Chez Infirmia, 95 % des consultations se passent du recours au médecin. Par ailleurs, pour vérifier que les services répondent aux exigences de chacune des professions, l’OIIQ et le Collège des médecins ont mis en place des mécanismes spécifiques.
Un cadre législatif à actualiser
Cette mouvance reste à baliser davantage. Ces dernières années, les cliniques essaiment dans la province canadienne, devançant un cadre législatif en cours d’ajustement. Face à l’engouement des patients et des infirmières qui aspirent à pratiquer autrement que sous l’égide médicale, l’OIIQ et le Collège des médecins planchent en ce moment sur un nouveau cadre de pratique. En attendant, les balises existantes en matière de droits, obligations et responsabilités des infirmières assurent le cadre actuel.
Il existe plusieurs degrés de formation et de responsabilité chez les infirmières québécoises. Toutes ne sont pas autorisées aux mêmes actes. En clinique privée, elles bénéficient d’un système d’ordonnances collectives. Pré-signées par un médecin, elles permettent aux infirmières de pratiquer certains actes. Par exemple, un lavage d’oreilles, considéré comme un acte médical, peut ainsi être effectué sur ordonnance par une infirmière pré-autorisée. Au Québec, le champ d’exercice des infirmières comprend dix-sept activités réservées.
>> LIRE AUSSI – Québec : les infirmières et les infirmiers auront le droit de prescrire dans certaines situations cliniques >>
Des « petits actes » et de la bobologie
Mélanie Sicotte et Marie-Ève Lachance, les deux fondatrices et propriétaires de la Clinique de soins infirmiers de Lévis, en banlieue de Québec, trouvent dans cette pratique une liberté jamais éprouvée durant leurs années au sein d’un réseau de santé public. « Aux urgences, les aberrations devenaient frustrantes, raconte Marie-Ève. Je n’étais pas habilitée à donner des analgésiques de base sans l’approbation du médecin. C’est d’autant plus absurde que les patients n’avaient qu’à traverser la rue pour en trouver en vente libre à la pharmacie d’en face. »
Mélanie et Marie-Eve avaient envie de faire mieux, autrement. Dépistage de maladies sexuellement transmissibles, vaccination, pilule du lendemain… Autant de « petits » actes qu’elles assument désormais quotidiennement de manière autonome et qui sont complémentaires au médical. « Nous ne sommes pas formés pour traiter un cancer et ce n’est pas ce à quoi nous prétendons. Nous faisons beaucoup de bobologie », vulgarise Isabelle Lechasseur.
Ainsi, Annie Brisson, première patiente de la Clinique de Lévis est venue aujourd’hui pour un vaccin qui aurait été fait gratuitement dans un centre local de santé communautaire (CLSC, réseau public) sans trop d’attente, mais elle a opté pour la clinique afin « d’encourager Mélanie et Marie-Eve ». « J’ai un médecin de famille dans un CLSC, mais je ne reçois pas le même service. Ici, je ne suis pas un numéro », précise-t-elle. Son assurance privée rembourse une partie des frais. Les patients sans couverture privée peuvent bénéficier d’une déduction d’un impôt à hauteur de 30 % du coût de ces soins privés.
Le sens du soin et des affaires
Si elles revendiquent d’abord le statut d’infirmière, il faut un véritable esprit entrepreneurial pour se lancer. Chez Infirmia, tous jonglent avec les termes « patients » et « clients ». Il s’agit de développer et de fidéliser la clientèle, d’assurer toute la gestion administrative et quotidienne de la clinique, et bien entendu de rentrer dans ses frais : ces infirmières allient le sens du soin à celui des affaires. Ainsi, David Tremblay Deschênes ne compte pas ses heures mais il les estime à près de 70 par semaine. Autrefois employé du réseau public, il travaillait 35 heures pour un meilleur salaire. « Sauf que là, ce n’est pas du travail, c’est mon univers et je pratique selon mes valeurs », affirme-t-il.
À raison de dix à vingt-cinq patients par jour, la Clinique de Lévis compte autour de 4 350 patients. Mélanie Sicotte estime qu’idéalement elle devrait consacrer 50 % de son temps de travail au développement d’affaires. En ce moment, c’est plus de 10 %, le reste étant consacré aux soins, pour répondre à l’engouement des patients.
Il faut compter autour de 30 $ pour une ouverture de dossier, 30 $ pour une demi-heure de consultation avec une infirmière clinicienne, 80 $ avec une IPS-PL, 40 $ les 15 minutes supplémentaires ainsi que des frais en sus pour les examens (prélèvements sanguins et d’urine, analyses…). Libres d’appliquer les tarifs qu’elles veulent, les cliniques tentent de s’aligner sur ceux pratiqués par d’autres professionnels de santé (ostéopathes, massothérapeutes, psychologues…).
Si le modèle permet aux infirmières d’exercer au meilleur de leurs compétences, l’OIIQ estime que les soins de santé, même dispensés en pratique privée, devraient demeurer couverts par l’État. « Ce sont des lacunes de notre système de santé public qui poussent les gens à se tourner vers le privé et conduisent à l’essor de ces cliniques », conclut Suzanne Durand
Les différents types d’infirmières
Les infirmiers praticiens spécialisés (IPS) sont les seuls à pouvoir pratiquer des actes médicaux réservés (prescription de tests d’investigation, prescription de traitements, application de traitements, actes invasifs, sutures de plaies superficielles). Le tout encadré par un règlement conjoint entre l’OIIQ et le Collège des médecins. Ce sont ces deux mêmes ordres qui délivrent leur certification aux IPS, obtenue après une formation universitaire de deuxième cycle.
Les infirmières cliniciennes et les cliniciennes spécialisées obtiennent leur diplôme après un minimum de trois ans d’études post secondaires. Toutes peuvent pratiquer les dix-sept activités réservées à leur profession (parmi lesquelles la vaccination, l’ajustement de traitements médicaux, la préparation de médicaments, la prescription de tests et d’analyses).
Les infirmières auxiliaires disposent d’une formation technique (comparable à une niveau BTS) et sont régies par leur propre ordre professionnel. Elles ne disposent pas des qualifications nécessaires à une pratique autonome.
Sabsa, la Coop Santé

Dans un quartier populaire de la ville de Québec, la coopérative de santé Sabsa a ouvert ses portes en partant du même constat que ses acolytes privés, mais en optant pour un modèle différent. Ici, les soins gratuits ciblent les patients délaissés par le réseau public.
« Nous l’avons fondé bénévolement, en investissant du temps et de l’argent », raconte Isabelle Hétu. L’équipe comptait au départ deux infirmières et une intervenante psychosociale, soutenues par des médecins partenaires.
L’idée initiale était de développer des services pour les patients atteints d’hépatite C, de leur donner accès à un traitement et un suivi. Rapidement, l’équipe constate que les patients ont d’autres besoins et que leur désorganisation sociale et psychologique les éloigne des ressources en santé publique.
Au fil des années, la coopérative (désormais en partie soutenue financièrement par des fonds publics) est devenue une porte d’entrée dans le système de santé pour les plus démunis.
« En tant qu’IPS Infirmière Praticienne Spécialisée, précise Isabelle Hétu, je peux dispenser beaucoup de soins et c’est plus facile, pour le patient, d’accéder à un médecin après être passé par Sabsa. Quand je le réfère, je sais que je ne le lance pas dans le vide car nous communiquons très bien. Les médecins savent que notre collaboration leur permet de se concentrer sur des problématiques plus lourdes. Et moi je me sens plus utile, avec le sentiment d’avoir un plus grand impact. »
Sophie Mangado

Abonnez-vous à ActuSoins Magazine à partir de 9,90 € par an, c’est ICI.


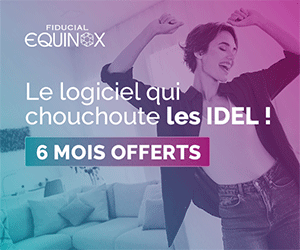





Enfin du bon sens inspirons nous des autres pays .Les nurses en Angleterre ont des responsabilites dignes de ce nom elle ne font pas de nursing par exemple donnons sa place à l infirmière donnons sa place à l aide soignante donnons sa place à l auxiliaire de vie …..respectons ces professions difficiles toutes ne peuvent pas tout faire
Mais enfin, Monique, t’as repris du service ? Où ?
Jeremy Siffert
Coline Guellec on en parlait
Non mais ça coûte moins chère au système pour le même acte, c’est une remarque
Et vous trouvez normal d’être si peu payé pour le même travail?
À concarneau ???
Elles où ils ….?? rectification.!! Je milite trop pour l’hôpital d’ici ….??
et sinon, toux ceux et celles qui ont des DU, pourquoi ne pas se battre pour que ces compétences soient reconnues ? au lieu de rajouter encore une couche, un échelon et ainsi catégoriser encore plus la profession ?
c’est lourd sa 😉