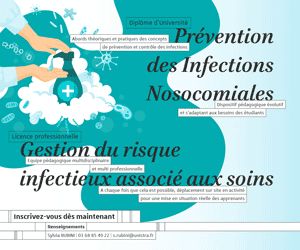Bien qu’ancienne, la profession infirmière ne s’est constituée en force capable de se mobiliser pour défendre ses intérêts que récemment. Et encore, cette transformation est fragile, si bien que la flamme des mouvements infirmiers semble devoir être ravivée en permanence.

Elles ont été délaissées pendant des dizaines d’années […]. Elles ont été soumises à des travaux écrasants, sans horaire […]. Elles ont fait cela avec un statut misérable, sans reconnaissance véritable. Alors maintenant la colère est là. Comment ne pas la comprendre ? » Le « elles » que désignent ces mots* datant de 1988, ce sont les infirmières. Quant à leur auteur, il s’agit tout simplement du président de la République de l’époque, François Mitterrand. Il faut dire que le locataire de l’Élysée venait alors de voir surgir quelque chose d’inédit : une mobilisation infirmière. La profession, jusqu’ici silencieuse, ou noyée dans la masse des mouvements syndicaux traditionnels, venait de mettre 100 000 de ses représentants dans la rue. Du jamais vu, et on en était abasourdi jusqu’au sommet de l’État. Quelque chose avait changé, mais on se demandait alors exactement quoi. Et dans une certaine mesure, cette interrogation demeure aujourd’hui.
Pour bien comprendre comment ce mouvement a pu émerger, et comment il a pu (ou a eu du mal à) s’inscrire dans la durée, il faut se remémorer le contexte de l’époque. « Pendant très longtemps, il n’y a pas eu de syndicalisme infirmier, rappelle Anne Perraut Soliveres, cadre de santé à l’époque et aujourd’hui (entre autres) directrice de la rédaction de la revue Pratiques. Il n’y avait d’ailleurs pas ou peu d’infirmières dans les syndicats quels qu’ils soient, elles ne voulaient pas y aller. »
Cet article a été publié dans le n°50 d’ActuSoins magazine (janvier 2024).
Il est à présent en accès libre.
Pour recevoir un magazine complet tous les trimestres, abonnez-vous
Ce contexte pouvait paraître atone, mais il a suffi d’une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Ce fut le décret Barzach, du nom de la ministre de la Santé de l’époque. Ce texte, daté de décembre 1987, entendait supprimer l’obligation d’être titulaire du baccalauréat pour entrer dans ce qu’on appelait alors les écoles infirmières. Un camouflet pour un corps professionnel qui, déjà, manquait de reconnaissance.
« Cela bradait la profession infirmière », s’indigne encore aujourd’hui Éric Audouy, infirmier à l’AP-HM. Ce cadre historique de la Coordination nationale infirmière (CNI), l’organisation née du mouvement de 1988, était alors « élève infirmier » (autre expression d’époque), et il garde un vif souvenir de cette mobilisation. « Je me souviens que les CRS ont employé des canons à eau contre les infirmières, cela a provoqué un émoi assez important », se remémore-t-il. Éric Audouy est loin d’être le seul à avoir été marqué par la mobilisation de 1988. « Pour la fameuse manifestation des 100 000 infirmières, nous avions organisé avec deux ou trois copines un train spécial pour monter de Toulouse, relate Jean Vignes, alors infirmier de secteur en psychiatrie dans la ville rose. Faire monter 500 infirmières de Toulouse pour une manif’ à Paris, c’est quelque chose qu’on n’a jamais revu. Et moi, j’étais chef de train, c’est bien la seule fois de ma vie que ça m’est arrivé ! » Les slogans alors scandés à l’époque, de « ras la seringue » à « ni bonnes, ni nonnes, ni connes », sont eux aussi restés dans les mémoires, ce qui témoigne de la profondeur du mouvement.
Victoire à la Pyrrhus ?
Mais si l’ampleur de la mobilisation de 1988 peut sembler extraordinaire au vu de ce que l’on peut observer aujourd’hui, les revendications qui étaient alors portées, elles, semblent étrangement familières à l’oeil contemporain : en plus de l’abolition du décret Barzach, la coordination demandait des hausses de salaires, une amélioration des conditions de travail, des augmentations d’effectifs, une revalorisation statutaire, un meilleur accès à la formation… Autant de mots d’ordres qui sont, pour beaucoup, encore d’actualité aujourd’hui. Voilà qui pose la question de la trace réelle qu’a pu avoir, au-delà de la marque qu’il a imprimée dans les consciences collectives, le mouvement de 1988. Et le bilan est pour le moins en demi-teinte.
Certes, le décret Barzach a été abandonné : le bac est resté requis pour accéder la formation infirmière. Des augmentations sensibles de salaires ont par ailleurs été obtenues. Mais comparées à ce qu’on pouvait observer dans d’autres pays, les rémunérations infirmières françaises sont restées dans le bas de l’échelle. On peut aussi noter qu’un syndicalisme proprement infirmier a émergé du mouvement de 1988 : la coordination infirmière initiale, qui était officiellement une organisation asyndicale et apolitique, s’est dissoute dès 1989, et de ses cendres a émergé, au prix de nombreuses scissions, la CNI, syndicat qui continue aujourd’hui à exister. Mais on ne peut pas non plus dire que celui-ci est devenu hégémonique.
« Nous avons réussi à transformer l’essai en déposant des statuts dans quelques villes, en nous présentant aux élections et en ayant des succès dans beaucoup d’hôpitaux, se souvient Pierre Bertaud, alors infirmier à Poitiers et responsable historique de la CNI. Mais cela s’est un peu perdu dans le temps, nous n’avons pas réussi à construire un syndicat élargi avec une véritable implantation nationale : à Poitiers, par exemple, nous sommes restés le premier syndicat, mais c’est loin d’être le cas partout. » Aujourd’hui encore, malgré l’existence de ces nouveautés issues du mouvement de 1988 que sont les syndicats infirmiers, on ne peut que constater que leur importance numérique est loin d’égaler celle des grandes centrales vers lesquelles se tourne encore une majorité de la profession.
Un effet durable

C’est ainsi que les infirmiers entrés dans le métier au cours de la décennie 1990, puis 2000, ont contracté une habitude que leurs aînés ne connaissaient pas : celle de descendre périodiquement dans la rue. « Il y a eu les grands mouvements des infirmières de bloc opératoire en 2000, quand on voulait autoriser les chirurgiens à utiliser des aides opératoires qui n’étaient pas des soignants, détaille Éric Audouy. En 2003-2004, nous avons également obtenu la reconnaissance de la pénibilité du métier et sa prise en compte pour la retraite, même si cette avancée a été balayée depuis. Et en 2007, il y a eu un grand mouvement à l’occasion de la réforme LMD [Licence-master-doctorat, N.D.L.R.]. » La profession a donc progressivement acquis la conscience de son existence non pas comme somme d’individus, mais comme corps social.
« D’une certaine manière, on peut considérer que l’évolution actuelle de la profession, avec par exemple la constitution de l’Ordre infirmier, découle de ce qui s’est passé en 1988, estime Jean Vignes. L’Ordre infirmier était en tout cas dans la tête d’une partie des personnes du mouvement. » Et il faut le rappeler, cette évolution ne fait toujours pas l’unanimité au sein de la profession.
« Je n’ai jamais manifesté avec la Coordination, cela me mettait hors de moi », se souvient Anne Perraut Soliveres, pourtant très engagée syndicalement. En tant que cadre, elle a « tout fait pour que [ses] collègues puissent aller manifester et qu’ils ne soient pas pénalisés », mais sur le fond, leurs visions divergeaient. « Comme eux, je cherchais une reconnaissance de la profession, mais une reconnaissance qui serait plutôt du côté de l’humain que du côté technique, scientifique, analyse-t-elle. J’ai continué à me battre pour les salaires, pour améliorer les conditions de travail, pour une organisation du travail qui permette des soins de qualité, pas pour un titre qui vous donne quelques sous en plus mais qui n’améliore pas la qualité des soins. »
Les pigeonnes montent au créneau

Reste que si ces luttes peuvent paraître lointaines aux infirmiers d’aujourd’hui, ceux-ci ont su renouveler les manières de défendre la profession en s’appropriant notamment les possibilités offertes par les réseaux sociaux. C’est ainsi qu’en 2012 est né sur Facebook le collectif « Ni bonnes, ni nonnes, ni pigeonnes », reprenant le slogan de 1988 et le remettant au goût de l’époque (les médecins venaient alors de créer de leur côté le collectif « les médecins ne sont pas des pigeons »). « Tout a commencé par un appel d’une infirmière anonyme sur les réseaux sociaux », se souvient Sarah Guerlais, qui était alors Idel en région parisienne et qui fut vice-présidente de l’association. L’appel dénonçait « la pénibilité et la dégradation constante » des conditions de travail « qui contribuent à la mise en danger du patient ». « Quel que soit le secteur dans lequel on travaillait, on était concernée par le fait que notre profession n’était pas reconnue », décrypte Sarah Guerlais.
En ce début des années 2010, Facebook était une formidable caisse de résonnance pour celles qu’on s’est rapidement mis à appeler les « Ni bonnes ». « C’était un groupe fermé sur lequel nous avons eu jusqu’à 40 000 membres », s’étonne encore aujourd’hui l’ex-vice-présidente. Mais tout n’était pas virtuel dans ce collectif. « Nous avons fait des actions symboliques, se souvient- elle. Nous nous sommes par exemple rassemblés place des Droits de l’homme à Paris, et nous nous sommes mis dans des housses mortuaires. Nous avons également fait des simulacres de pendaison place de la Bourse pour dénoncer les suicides dont la profession était victime. » L’une des forces du mouvement, un peu comme celui de 1988, était de paraître indépendant des organisations politiques et syndicales. « Beaucoup venaient parce qu’ils savaient qu’on était sans couleur, ils ne voulaient pas avoir d’étiquette, c’est comme ça qu’ils se reconnaissaient le mieux », souligne l’ancienne militante.
Reste que cette indépendance vis-à-vis des mouvements déjà constitués était également une faiblesse. Sans représentation dans les instances des établissements ou face aux caisses d’Assurance maladie, il était difficile de perdurer. Et bien que les « Ni bonnes » se soient constituées en association loi 1901, le soufflé a fini par retomber. « Il y a tout de même eu beaucoup de mouvements locaux de grève dans les établissements à cette période », relativise Sarah Guerlais, qui estime que l’élan créé par l’appel de 2012 a aussi pu aider « certaines personnes qui étaient proches du burnout » à retrouver un sentiment d’appartenance collective qui les a sorties d’une mauvaise passe.
L’inter-urgences sème la révolte
Et le mouvement des « Ni bonnes » n’est pas la dernière mobilisation en date. Juste avant la crise sanitaire, c’est d’un mouvement infirmier qu’est parti l’immense embrasement qui avait enflammé l’hôpital à l’automne 2019, culminant avec des manifestations rassemblant le 14 novembre 2019 des dizaines de milliers de personnes dans toutes les villes de France à l’appel du Collectif inter-hôpitaux (CIH). Or avant le CIH, regroupement rassemblant tous les soignants de toutes les professions, il y avait eu le Collectif inter-urgences (CIU), centré autour du monde paramédical et des urgences, et principalement animé par des infirmiers. Celui-ci est « issu de la volonté des paramédicaux […] de porter l’amélioration des conditions de travail et d’accueil dans les structures d’urgence », écrit Hugo Huon, l’infirmier qui en fut le président, dans un livre collectif où les participants relatent cette aventure**.
Là aussi, les infirmiers ont su trouver des modes de revendication originaux. Non seulement ils ont réussi à mettre simultanément en grève jusqu’à 270 services d’urgence dans le pays, mais ils ont aussi su capter l’attention de l’opinion publique. Un exemple qui en vaut cent : rassemblés devant le ministère de la Santé en juillet 2019, une dizaine de membres du CIU se sont injecté un produit qu’ils ont présenté comme de l’insuline, mettant directement leur vie en péril pour montrer la détresse dans laquelle se trouvaient leurs établissements. C’est sur la base de leur contestation que s’est fondé quelques mois plus tard le CIH, dont l’ardeur revendicative avait atteint un niveau rarement égalé dans le monde hospitalier avant d’être étouffée par le covid. La flamme peut-elle se ranimer ? « On n’arrivera plus à mettre 100 000 infirmières dans la rue, estime Éric Audouy. Il faut trouver d’autres moyens pour faire pression sur le gouvernement. Je n’ai pas le secret pour trouver la bonne méthode, mais il va bien falloir que quelqu’un la trouve ! »
Et ils sont où ? Et ils sont où ? Et ils sont où les infirmiers libéraux ?

Pourquoi parle-t-on plus souvent des mouvements infirmiers quand ils se déroulent à l’hôpital que quand ils se déroulent en ville ?
Il y a d’abord un effet de masse. La majeure partie de la profession travaille à l’hôpital, et il est naturel que les mouvements hospitaliers soient plus suivis. Il y a également une question de visibilité. Nous avons aujourd’hui dans le monde libéral un problème d’affichage, et on nous l’a bien fait remarquer pendant le covid : nous sommes en quelque sorte invisibles.
Cela veut-il dire qu’il n’y a pas de mobilisations chez les Infirmiers libéraux ?
Non, bien sûr ! Je me souviens de manifestations assez dures en 2001, par exemple. Nous avions manifesté devant la Cnam, et il y avait eu des gardes-à-vues. Il s’agissait de protester contre le blocage tarifaire que nous supportions depuis des années : il n’y avait aucune promesse d’ouverture de négociations, pas de perspective pour les professionnels, et nous sommes allés chercher une augmentation tarifaire avec les dents.
 Est-ce le seul exemple que l’on peut citer ?
Est-ce le seul exemple que l’on peut citer ?
Non, je me souviens par exemple d’un mouvement de campement devant les CPAM [Caisses primaires d’Assurance maladie, N.D.L.R.] en 2003. Nous voulions revenir à la table des négociations avec une meilleure prise en compte de nos contraintes, et nous avions un barnum que nous installions devant les échelons locaux de l’Assurance maladie. Dans les départements où nos organisations étaient les plus actives, nous avons tenu jusqu’à trois semaines de campement.
Le fait que beaucoup d’enjeux touchant les libéraux soient discutés dans un cadre conventionnel avec l’Assurance maladie change-t-il la donne en termes de mobilisation ?
C’est certain. On voit notamment que dans les années 2000, quand nous avions une négociation quinquennale et que peu de choses se passaient entre deux négociations, de fortes attentes étaient générées. Cela pouvait parfois conduire à de fortes déceptions, et donc à des mobilisations dures. Aujourd’hui, nous sommes dans une négociation quasi permanente avec l’Assurance maladie, et bien que les attentes n’aient pas disparu, elles ont changé de nature. On est dans une pratique des petits pas plutôt que du grand saut, ce qui a des avantages et des inconvénients.
Le morcellement du paysage syndical en libéral est-il selon vous une faiblesse ?
Il y a un changement de paradigme qui s’est opéré dans le rapport des professionnels aux organisations syndicales. Aujourd’hui, quand on adhère un syndicat, on demande ce à quoi cela nous donne droit en contrepartie. Cette forme de consumérisme, combinée avec l’émergence des réseaux sociaux, explique en partie une forme de désaffection pour le syndicalisme. Mais à la FNI, nous avons un taux moyen de progression des adhésions de 10 % par an, le syndicalisme n’est donc pas mort !
Doit-on s’attendre à un grand mouvement libéral dans les années à venir ?
Il pourra y avoir des mouvements sporadiques tels que ceux qu’on a connus dans les dernières années. Mais je ne crois pas vraiment à un grand mouvement unitaire de la profession. Nous avons une connaissance empirique de l’efficacité de ces méthodes : on voit bien que quand la SNCF bloque le pays pendant six mois contre la réforme des retraites, ils n’obtiennent pas gain de cause, ce ne sont donc pas quelques milliers d’Idels devant le ministère de la Santé qui vont changer quelque chose. À la FNI, nous considérons qu’il ne s’agit pas de la méthode la plus efficace, et que les choses se passent davantage dans les coulisses, dans les relations parfois dures que nous pouvons avoir avec le ministère de la Santé, Bercy, Matignon, la Cnam… Et nous nous estimons que quand en septembre 2021 par exemple, nous avons publié une lettre ouverte au président de la République dans l’intégralité de la presse quotidienne régionale, cela a fait plus d’effet qu’une manifestation.
Adrien Renaud
Je m'abonne à la newsletter ActuSoins
Cet article a été publié dans ActuSoins Magazine
Il est à présent en accès libre.
ActuSoins vit grâce à ses abonnés et garantit une information indépendante et objective.
Pour contribuer à soutenir ActuSoins, tout en recevant un magazine complet (plus de 70 pages d’informations professionnelles, de reportages et d’enquêtes exclusives) tous les trimestres, nous vous invitons donc à vous abonner.
Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI
Abonnez-vous au magazine Actusoins
* Cités par l’historien François Chevandier dans le magazine L’Histoire en février 2021
** Hugo Huon, Le Collectif Inter Urgences, Urgences, Albin Michel, 2020






 Est-ce le seul exemple que l’on peut citer ?
Est-ce le seul exemple que l’on peut citer ?